La bibliothérapie au service de la jeunesse

Il y a quelque temps, j’ai découvert un univers nouveau et merveilleux : celui de la bibliothérapie pour la jeunesse. Je connaissais déjà les vertus bénéfiques que procurait la lecture de certains ouvrages, en particulier ceux traitant du développement personnel. Ces suggestions, recommandées entre autres par un spécialiste, s’instaurent généralement dans le cadre d’une intervention thérapeutique ou médicale. À ma grande surprise, cependant, j’appris qu’il existait également des ateliers menés par des intervenants divers. Ces derniers se servaient entre autres de la lecture d’extraits de romans ou de nouvelles afin de venir en aide aux enfants et adolescents.
Par conséquent, les livres sont utilisés non pas uniquement comme simple divertissement, mais aussi en tant que traitement pour soulager les maux rencontrés par l’enfant… à l’aide des mots ! L’article d’aujourd’hui a pour objectif de distinguer les deux branches de la bibliothérapie : l’approche clinique face à l’approche d’accompagnement auprès des jeunes.
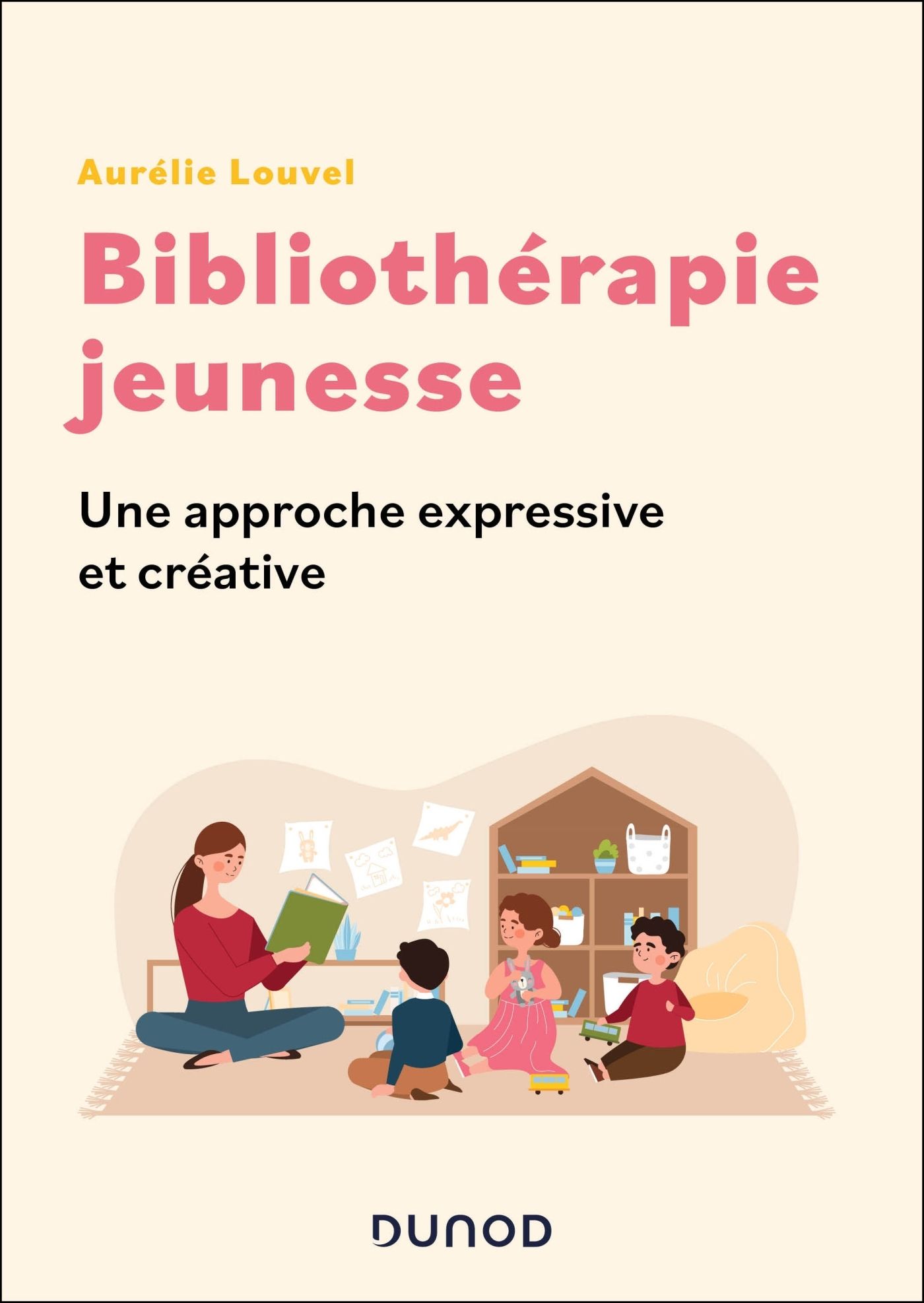
Les origines et formations disponibles
Avant d’aller plus loin, il faut savoir que cette idée a d’abord émergé aux États-Unis durant la Première Guerre mondiale, grâce à l’initiative de la bibliothécaire Sadie Paterson Delaney. Cette dernière a mis au point le projet de se servir des livres afin d’aider les soldats à panser leurs blessures tant physiques que psychologiques. Elle en a rapidement constaté les bienfaits et fondée par la même occasion une pratique encore utilisée de nos jours. Par la suite, la bibliothérapie s’est répandue en Europe où plusieurs formations sont offertes à tous ceux et celles désirant s’y initier, notamment en Suisse et en France. L’une d’entre elles – dont j’ai moi-même bénéficié – est spécifiquement dédiée aux animateurs désirant officier dans le milieu jeunesse.
Créée par la Française Aurélie Louvel et disponible à distance, cette formation permet la réalisation de chacune des étapes menant à la création d’un atelier. On y apprend aussi comment l’animer le moment venu. Sa fondatrice est également l’autrice du livre « Bibliothérapie jeunesse : une approche expressive et créative », véritable mine d’or pour tous ceux et celles désirant en savoir plus sur les bienfaits du livre auprès des jeunes. Plus près de nous, au Québec, la seule et unique entreprise à offrir ce service est la Bibliothèque Apothicaire fondée et dirigée par Katy Roy. Lors d’une entrevue menée par Aline du podcast « Des livres pour cheminer », cette dernière déclare :
« J'ai effectivement commencé à donner de la formation à l'automne dernier. (…) j'ai formé deux bibliothécaires à l'approche de la bibliothérapie. C'était un premier bloc de formation de cinq jours et on a abordé la bibliothérapie de manière globale. Pendant la formation, la personne reçoit quelques séances (…) aussi pour expérimenter (soi-même) ce travail-là. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. »
Mme Roy affirme aussi que « le travail avec l'imaginaire est pour moi fondamental dans cet outil de la bibliothérapie. Un autre aspect que je trouve important (…) c'est la rencontre en face à face. » Son œuvre « La bibliothérapie trésors d'imaginaires », parue en 2018 aux éditions Fides, permet d’en apprendre davantage sur sa pratique et son approche. Il relate également ses expériences parmi différents milieux d’intervention.
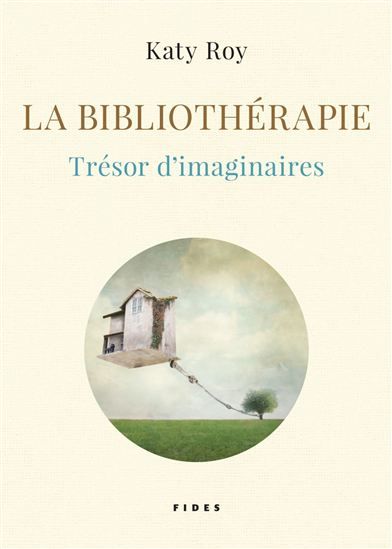
Les types de bibliothérapies
Revenons-en aux différentes formes de bibliothérapie existantes. En vérité, cette dernière est semblable à un arbre : le tronc s’incarne ici comme étant l’usage du livre au cœur de l’activité et ses nombreuses branches adoptent des méthodes diverses afin de l’utiliser. Notons entre autres l’approche intuitive, imaginale, clinique et d’accompagnement. Toutefois, pour les besoins de l’article, nous développerons seulement les deux dernières ci-mentionnées. D’abord, il faut savoir que la différence majeure entre les deux formules demeure la spécialisation de ses animateurs. La première est menée par des professionnels issus du milieu médical : psychiatre, psychologues, infirmiers ou infirmières, ergothérapeutes, etc.
Dans ce cadre-ci, il est nécessaire de posséder un diplôme, souvent un doctorat. L’approche d’accompagnement, toutefois, concerne autant les professionnels du livre que de l’éducation. Bibliothécaires, enseignants, auteurs et travailleurs sociaux, pour n'en nommer que quelques-uns, peuvent donc intervenir en tant qu’animateurs de bibliothérapie. Dans ce contexte, l’objectif principal consiste surtout à faire réfléchir les jeunes et à provoquer chez eux une réflexion ou une émotion. C’est sur ce type d’intervention auquel je m’attarderai plus particulièrement.
Concrètement ça se passe comment ?
Lors d’un atelier, les séances se déroulent en quatre étapes. En premier vient la lecture à haute voix. Celle-ci est sans doute l'étape la plus importante. En effet, par le texte, l'animateur transmet un univers narratif dont le rôle est de faire le pont entre le vécu du patient et les émotions qui se dégage de l’histoire. Durant cette lecture, le jeune s’identifie aux personnages ou aux événements décrits, même si c’est seulement de manière inconsciente.
Une fois terminée débute le cercle de parole. Dans un contexte d’atelier avec un jeune public, l'animateur ou l'animatrice guidera les enfants sur des questions relativement différentes de celles à proprement dites scolaire. Ici, il ne s’agit pas d’évaluer/valider la compréhension, mais plutôt le ressenti des enfants face à la lecture. Aussi, les questions seront d’ordre socio-émotionnel ; durant quel passage as-tu ressenti de la peur/colère/joie/tristesse? Comment le personnage exprime-t-il ses émotions ? Penses-tu que le personnage a eu raison de faire ce qu’il a fait ? Aurais-tu agi de la même façon à sa place ? Par un questionnement dirigé, donc, l’animateur-trice en viendra peu à peu à créer un parallèle qui amènera l’enfant à s’ouvrir en toute confiance – s’il le souhaite – sur des éléments de sa vie personnelle.
Ensuite arrive la période de transition. Par la visualisation, méditation ou autres procédés de détente, celle-ci octroie une pause durant laquelle l’enfant ou l’adolescent peut se laisser porter par les images suscitées grâce à l’histoire.
Enfin, l’atelier se conclut avec une activité d’ordre créative. Celle-ci varie selon l’âge de son public. Ainsi, pour un groupe de premier cycle primaire, le dessin, le bricolage et la peinture seront priorisés tandis que l’écriture s’ajoutera aux autres formes d’arts et d’expressions auprès des adolescents.
Ce qu’il faut retenir
En résumé, on peut affirmer que la bibliothérapie mérite de prendre de l’expansion dans notre province. En effet, son approche à la fois métaphorique et interactive ouvre la porte à des impacts positifs chez les jeunes, en particulier sur le plan émotionnel et relationnel. Par des ateliers bien articulés et motivants, les intervenants du milieu médical, du livre et de l’éducation parviennent à toucher le cœur et l’esprit des enfants et adolescents parfois aux prises avec des situations anxiogènes. Finalement, l’insertion de ces ateliers à leur activité principale peut conduire animateur et client à de belles découvertes ce qui étoffera la culture littéraire et artistique de façon incontestable.