Enseigner le roman policier : une approche classique ou moderne ?
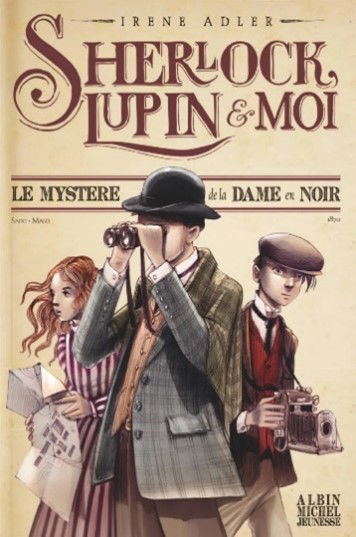
Le roman à enquête : une approche pédagogique
Il va de soi, durant le programme scolaire, d’apprendre aux élèves divers genres de lecture. Cela va du conte à la poésie, en passant par les documentaires jusqu’aux bandes dessinées. Parmi eux se trouve évidemment le roman policier. Né sous la plume d’Edgar Allan Poe avec son ouvrage Double assassinat dans la rue Morgue, et popularisé ensuite par des auteurs de renom tels que Stephen King et Mary Higgins Clarks, ce genre connaît un engouement qui ne se dément pas.
Cependant, si ce type d’ouvrage* est fort prisé par ses lecteurs au fil des générations, il l’est nettement moins auprès des étudiants adolescents. Enseigné au premier cycle du secondaire, le roman policier, en effet, s’avère difficilement accessible non seulement pour les élèves en difficulté, mais également pour les lecteurs réguliers. Il faut savoir que pour démontrer la structure narrative des ouvrages à enquêtes, l’œuvre la plus souvent utilisée par les professeurs au Québec est Sherlock Holmes. Un roman écrit par nul autre que le maître incontesté Sir Arthur Conan Doyle.
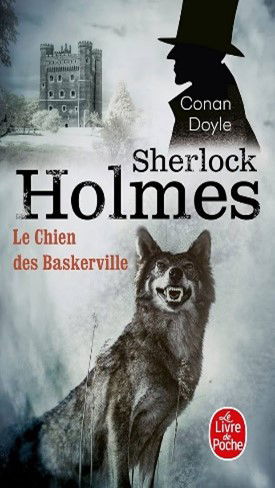
Sherlock Holmes : du détective à l’enseignant
Couramment étudiée, la lecture des volumes « Une étude en rouge » et « le chien des Baskerville », même si elle est très riche en culture, pose divers problèmes. Issue des aventures du fameux détective, les romans sont rédigés dans une langue soutenue qui peut rebuter même les plus assidus d’entre nous.
Ce vocabulaire, sans parler des expressions anciennes, n’est pas adapté aux élèves, car non seulement sa lecture se situe-t-elle à un autre niveau, mais elle rejoint également très peu les jeunes d’aujourd’hui. Il serait possible de passer outre le décor de l’époque victorienne et édouardienne, si le récit mettait en scène des jeunes. Malheureusement, Sherlock Holmes présente majoritairement des personnages adultes ce qui empêche notamment toute possibilité d’identification pour le lectorat cible. Celle-ci demeure pourtant l’un des éléments clés afin de captiver l’intérêt des lecteurs, en particulier celui des adolescents.
Ces mêmes défis sont également rencontrés auprès de la seconde autrice de romans policiers la plus lue par les classes étudiantes : Agatha Christie. En effet, si la réputation de la célèbre plume britannique et spécialiste des histoires à énigmes n’est plus à faire, la lecture de ces romans demeure fastidieuse.
Car, outre les obstacles mentionnés plus haut, s’ajoute un nombre important de descriptions aux détails si fournis qu’elles en découragent plus d’un. De fait, il n'est pas rare que la mise en place des lieux, des personnages et de l’intrigue s’étale sur plusieurs chapitres. L’autrice étant, par ailleurs, généreuse en suspects, chacun de ses romans présente un éventail de personnages tous plus impressionnants les uns que les autres.
Très souvent, les élèves en viennent à confondre ces derniers et nombre d’entre eux ne peuvent s’y retrouver. J’ai moi-même pu constater ces barrières auprès de mes élèves en tant que tutrice en français. Tous ces aspects, à mon sens, empêchent le plein épanouissement de la lecture, qui est pourtant le but poursuivi par la découverte de genres littéraires apprise en classe.
Apprendre par la littérature jeunesse
Aussi, je me pose la question suivante : cela ne devient-il pas contradictoire ? Ne devrait-on pas plutôt encourager une histoire accessible avec un vocabulaire plus simple, mais porté par des voix modernes et empreintes d’enseignements ? L’une des solutions possibles pourrait se résumer en trois mots : la littérature jeunesse.
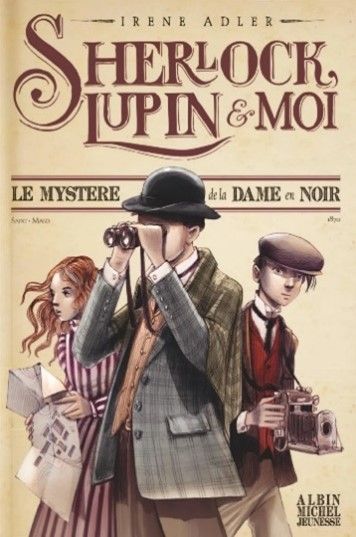
Car le problème se situe également à ce niveau ; les ouvrages dits classiques s’inscrivent dans un volet adulte et non pour adolescents. Toutefois, les versions utilisées par le cortège enseignant au secondaire sont de prime abord, celles qui se rapprochent le plus de l’édition originale. C’est-à-dire, avec un langage lexicalement poussé qui parvient surtout à semer l’incompréhension et le découragement chez les étudiants.
Ainsi, avoir recours à des romans jeunesse pourrait éventuellement sauver la mise. Non seulement la narration et les personnages sont-ils pensés, voire écrits en fonction de son jeune lectorat, mais ils traitent également des enjeux rencontrés par la majorité des adolescents et adolescentes.
De cette façon, les romans policiers pour la jeunesse peuvent aborder, parallèlement à l’enquête, aussi bien des divorces que des relations amoureuses, de l’amitié, du rejet, jusqu’aux émotions. S’il est possible de retrouver ces éléments au travers des romans policiers modernes chez les adultes, l’histoire développée est généralement plus sombre ou simplement inintéressante du point de vue des jeunes. Par ailleurs, en ce qui concerne les classiques, les défis du quotidien étant différents à l’époque, on n’y aborde pas ceux qui touchent les adolescents d’aujourd’hui.
Une forme originale pour revisiter les classiques
En dehors des avantages mentionnés ci-dessus, l’utilisation de romans pour enfants et adolescents peut également amener un apprentissage ludique et différent tout en renseignant les lecteurs sur des notions multiples. À l’international, par exemple, une série signée Irène Adler (en référence au personnage issue d’une nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle), propose de suivre le trio d’amis Sherlock, Lupin et Irène elle-même au travers de leurs aventures.
Non seulement, cette formule originale fait-elle connaître certains des plus grands personnages de la littérature policière, mais elle permet également/aussi de suivre les enquêtes d’un groupe adolescents ce qui augmente nettement l’identification du lectorat pour les personnages. De plus, le fait que ce titre soit le premier d’une série comportant dix-huit tomes ne gâche rien puisqu’il peut également inciter les élèves à découvrir les joies de la lecture en retrouvant un univers déjà familier à la maison.
Dans un même ordre d’idée, et venant de paraître à l’automne dernier*, le premier tome d’un même genre de série, Les mystères de Baskerville, voit des étudiants résoudre les énigmes et complots de leur internat. Encore une fois en hommage à l’univers de Holmes, ce livre a l’avantage de situer l’histoire dans un établissement scolaire ce qui rejoint d’autant plus les lecteurs puisque cela ajoute plusieurs enjeux relatifs au lieu et une hiérarchie sociale déjà vécue/bien connue par le lectorat.
Au Québec, certaines séries peuvent correspondre en ce sens, telle que l’histoire « Sarah-Lou détective très privé » de l’autrice Audrée Archambault. Cet ouvrage permet de suivre les enquêtes d’un groupe adolescents. De plus, le fait que le premier titre paru « S’il te mord, t’es mort ! » soit le premier d’une série comportant 4 tomes laisse de belles opportunités.
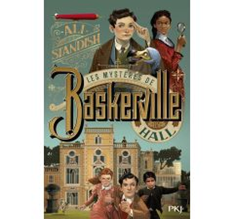
Du texte à l’image : les bandes-dessinées
En outre, pour les enseignants et enseignantes qui souhaitent associer l’image au texte, notons que certaines bandes dessinées peuvent s'avérer fort utiles. Enola Holmes, Dans la tête de Sherlock Holmes, Arsène Lupin et les Quatre de Baker Street, pour n’en nommer que quelques-unes, présentent à leur tour des univers dérivés des plus grands classiques de la littérature policière. Une belle façon d’augmenter l’intérêt des lecteurs tout en présentant un visuel attractif et une synthèse face au contenu du texte qui facilitera certainement le message transmis par l’histoire./la compréhension.
Enfin, si vous recherchez une collection BD québécoise, la série Fonck et Ponck saura vous plaire. Créée par un auteur d’ici et dont le dernier titre est paru en avril dernier, son auteur, Lucas Jalbert, s’est amusé à mettre en scène deux frères détectives dont le lecteur suit les aventures au cours de leurs différentes enquêtes. Le quatrième tome en particulier, intitulé « Le spectre noir », incarne de façon claire le schéma du récit policier. On y retrouve notamment la présence d’un tueur en série, plusieurs victimes connues des personnages, une ambiance inquiétante et des révélations surprenantes qui parviennent à tenir ses lecteurs en haleine tout en maintenant un ton empli d’humour.
En sommes, les animations continues de l’auteur dans les écoles contribuent à maintenir cette série vivante. Fort heureusement d’ailleurs, puisqu’elle possède certainement un potentiel pédagogique intéressant pour aborder le roman policier.
La nouvelle policière et production québécoise
Par la suite, le recueil de nouvelles « Mystère à l’école » rejoint cette mission : en effet, on y voit des étudiants résolver les énigmes et complots de leurs différentes classes. Écrit par un collectif d’auteurs, ce livre a l’avantage de situer l’histoire dans un établissement scolaire. Cela attire d’autant plus les lecteurs que cet élément ajoute plusieurs enjeux relatifs au lieu ainsi qu'une hiérarchie sociale déjà vécue par le lectorat.
Par ailleurs, ces diverses histoires au style aussi unique que leurs créateurs, permet non seulement de renseigner les élèves sur le récit policier, mais aussi sur le format de la nouvelle. Finalement, ces histoires suffisamment courtes et captivantes contribuent à maintenir l’intérêt des étudiants durant un laps de temps moins exigeant que pour un roman classique.
Parmi les auteurs participants, citons entre autres ; Simon Boulerice, Robert Soulières et Priska Poirier pour n’en nommer que quelques-uns. Placée sous la direction de Richard Migneault, la collection en est déjà à son quatrième recueil paru. Autant dire que les lieux d’apprentissages n’ont pas fini de dévoiler leur secret...
Ensuite, mentionnons que la collection Noire des éditions La Courte Échelle publie quant à elle, des romans à enquêtes dont la lecture et l’histoire demeurent accessibles à un jeune public. Côtoyant crimes et événements surnaturels, ces titres d’auteurs québécois contribuent à enseigner la trame d’un récit policier sans pour autant tomber dans les complications superflues.
Nommons par exemple, Rouge Poison écrit par Michèle Marineau (et publié d'abord chez Québec Amérique) est enseigné depuis sa parution en 2000, parmi certaines de nos écoles québécoises. L’ouvrage a notamment remporté le prix du livre M. Christie. Véritable roman policier par sa structure et son intrigue, l’auteure adresse cependant l’histoire aux adolescents ; ainsi, les personnages s’avèrent avoir le même âge que leur lectorat. Si l’enquêtrice est une adolescente ainsi que ses deux acolytes, les victimes le sont également ce qui accroît d’autant plus l’empathie des lecteurs et lectrices et leur désir de connaître l’identité du coupable.
Se tourner vers d’autres genres
Enfin, une autre formule originale à envisager consisterait à utiliser d’autres genres littéraires. La fantasy et le fantastique, par exemple, permettent d’établir et de repérer la structure d’un récit policier dans un roman qui, a priori, ne se situe pas dans cette catégorie. La série Anna Caritas, née de la plume de Patrick Isabelle, s’inscrit dans cette lignée.
L’enquête est menée par un groupe d’amis qui se retrouvent bien malgré eux embarqués dans une aventure qui les dépasse. Teinté de suspense et empruntant des caractéristiques propres au roman policier, ce récit dont le genre premier est le fantastique a de quoi tenir les élèves en haleine jusqu’à la dernière page. Le mystère est omniprésent et tous les éléments présents concordent avec la trame des romans policiers.
De plus, difficile d'aborder la fantasy sans mentionner une œuvre phrare : Harry Potter. Le deuxième tome des aventures du jeune sorcier Harry Potter et la chambre des secrets, présente de nombreuses caractéristiques propres aux livres à enquêtes ; en effet, les agressions répétées où des élèves se font pétrifiés, les suspects envisagés, l’investigation menée par les héros, les révélations dévoilées à la fin, tous ces éléments concordent avec la trame des romans policiers. Cela plairait sans équivoque aux élèves intéressés par des histoires se déroulant en dehors du récit réaliste tout en autorisant une évasion vers des univers où il y a beaucoup à apprendre notamment par le biais de morales véhiculées.
Le mot de la fin
En conclusion, nous pouvons espérer que le programme scolaire envisagera à l’avenir d’innover la façon d’inculquer le roman policier au secondaire. Pour le bien des élèves, il serait judicieux de se tourner vers d’autres manières d’enseigner les bases du récit à enquêtes, plutôt que de se cantonner uniquement aux classiques.
Les œuvres jeunesse et la variété des genres exerceraient une influence bénéfique sur l’intérêt et la motivation des étudiants à apprendre. Il y a certes une leçon à tirer de ces deux formules d’enseignements – l’une moderne et l’autre classique – mais je ne vois pas pourquoi il serait impossible de marier les deux ; après tout, l’une peut très bien inspirer l’autre dans un souci d’évolution et d’adaptation afin de correspondre aux besoins des étudiants d’aujourd’hui.
Finalement, quoi qu’on en dise, il est certain que la curiosité face à la lecture et à l’éducation ne s’en trouvera que décuplée davantage. Une telle amélioration serait plus que bienvenue afin d'augmenter le taux de réussite des adolescents et adolescentes dans les écoles.